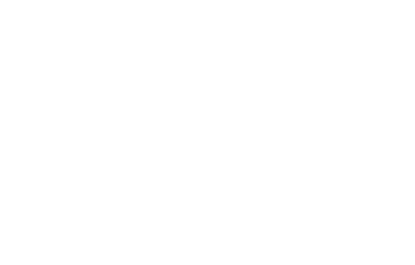Recherches et rédaction
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
La place se situe dans le quartier de Linthout, dont le plan de voiries est dressé en 1903-1904 par l'ingénieur communal des Travaux Octave Houssa et approuvé par l'arrêté royal du 24.06.1904 puis définitivement par celui du 21.04.1906, en même temps que ceux des trois autres nouveaux quartiers de Schaerbeek – Monrose, de la Vallée Josaphat et Monplaisir-Helmet.
Le square s'implante sur une partie du tracé de l'ancienne avenue de Cortenberg, fixé par l'arrêté royal du 20.06.1853. Beaucoup plus longue que dans sa forme actuelle, cette artère débutait au rond-point Robert Schuman puis bifurquait vers le nord, à hauteur de la future place de Jamblinne de Meux, pour rejoindre la chaussée de Louvain au niveau de l'actuelle place Général Meiser. Le tronçon compris entre les deux places sera rebaptisé avenue Eugène Plasky en 1909.
La dénomination de la place de Jamblinne de Meux est, quant à elle, attribuée en séance du Conseil communal du 16.05.1905. Elle honore, sur proposition de l'intéressé, le baron Théophile de Jamblinne de Meux (1820-1912), ingénieur en chef de la Ville de Bruxelles, qui proposa un avant-projet pour le tracé du quartier Nord-Est en 1870. La place n'est alors constituée que par un croisement de voiries dessinant plusieurs terre-pleins triangulaires.
Le 13.01.1913, une convention est passée entre l'État belge – la place appartenant à la grande voirie – et la Commune de Schaerbeek, en vertu de laquelle cette dernière reçoit plus de dix-huit ares du Gouvernement pour aménager deux terre-pleins arborés au centre du square. Cette convention est finalement modifiée en séance du Conseil communal du 18.11.1921, afin de faire du centre de la place un «jardinet-square» susceptible d'offrir un cadre satisfaisant au monument à la mémoire de Philippe Baucq, que l'on y prévoyait. Résistant fusillé par les Allemands le 12.10.1915, cet architecte habitait non loin de là, au no49 de l'avenue de Roodebeek. Dû au sculpteur Paul Vandekerkhove et aux architectes G.Heuchenne et G.Hendrickx, le monument fut inauguré le 20.07.1924 mais démantelé par les nazis en 1940.
En 1985, un accord est passé entre le Gouvernement belge et les Communautés européennes pour mettre en place une série d'infrastructures routières, dont la construction du tunnel dit de Cortenberg, devant relier la rue Belliard à l'autoroute E40 et passant sous la place. Alors que cette dernière était quotidiennement traversée par des navetteurs et avait été aménagée en conséquence au cours du temps, elle est complètement remodelée par le bureau A.2R.C (Architecture et Construction entre Rêve et Réalité) entre 1992 et 1994 suite au percement du tunnel. Le centre de la place s'organise désormais en un long square ceint de grilles et distribué en trois carrés liaisonnés par un portique en fer forgé. Les arbres anciens ont été maintenus. Une œuvre monumentale du sculpteur Miquel Navarro, baptisée Boca de luna, a été inaugurée le 15.04.1994: elle se décline en deux fontaines, l'une de treize mètres de haut, en acier peint, l'autre en laiton coulé.

La partie sud-est de la place, correspondant à l'ancienne avenue de Cortenberg et au début de l'ancienne chaussée de Roodebeek – aujourd'hui l'avenue du même nom –, était déjà, en 1870, bordée de plusieurs constructions, certaines implantées sur une propriété arborée. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'un large hôtel particulier néoclassique (voir no13a-15). En 1882, une autre vaste propriété se bâtit à front de voirie d'une maison de campagne, qui sera plusieurs fois agrandie (voir no7-9). En 1897, c'est un luxueux sanatorium conçu pour la Société L'Anglo-Franco-Belge qui s'installe à côté de l'hôtel particulier néoclassique, avec lequel elle formera en 1926 l'Institut de la Vierge fidèle et le siège de la congrégation du même nom (voir no13a-15). La partie nord-ouest de la place est, quant à elle, principalement édifiée entre 1908 et 1910. Elle comprend une enfilade remarquable d'immeubles de même gabarit, allant du no31 au no45 (voir ces numéros). Les parcelles restées vierges autour du square sont bâties dans l'entre-deux-guerres.
Les constructions de la place se déclinent pour la plupart en maisons bourgeoises, hôtels de maître et immeubles à appartements d'angle, oscillant entre éclectisme, Beaux-Arts et Art Déco. Citons notamment le no10 (architecte Servais Mayné, 1922), de style Beaux-Arts, les nos11 et 12 (architecte Ch.Van Elst, 1922), ainsi que le no19 et avenue de l'Opale no1 (architecte Victor Rubbers, 1923). En 1923, une imprimerie est établie à l'arrière du no27, où seront tirés les cours par correspondance de l'institut L'Avenir, implanté au no34-35 (voir ce numéro).
Sources
Archives
ACS/Urb. 64; 1-2: 64-1; 10: 64-10; 11: 64-11; 12: 64-12; 19: 64-19; 27: 64-27.
ACS/TP Dénomination des rues II.
ACS/TP Infrastructure 229, 375.
ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1912, pp. 798-800; 1921, pp. 963-964.
Maison des Arts de Schaerbeek/fonds local.
Ouvrages
DEROM, P. (dir.), Les sculptures de Bruxelles, Galerie Patrick Derom, Bruxelles, Éditions Pandora, Anvers, 2000, pp. 232-233.
DEROM, P., Les sculptures de Bruxelles. Catalogue raisonné, Galerie Patrick Derom, Bruxelles, 2002, p. 118.
Cartes / plans
HOUSSA, O., Plan des transformations de la commune de Schaerbeek, 1903 (Maison des Arts de Schaerbeek).
HOUSSA, O., Plan no2. Commune de Schaerbeek. Quartier de Linthout. Projet d'avenues et rues nouvelles, 26.09.1904 (ACS/TP).
Plan de la commune de Schaerbeek 1870, Institut géographique national.
Plan général de la commune de Schaerbeek 1911 in: BERTRAND, L., Schaerbeek depuis cinquante ans. 1860-1910, Librairie de l'Agence Dechenne, Bruxelles, 1912.