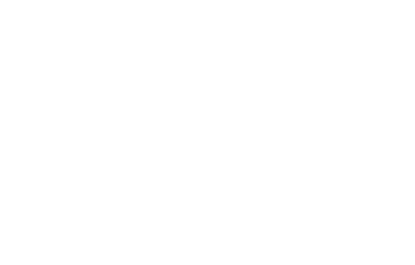Recherches et rédaction
2012-2013
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaireBordée d'arbres et légèrement arquée, l'avenue Albert Giraud relie le boulevard Lambermont au rond-point elliptique de l'avenue Huart Hamoir. Elle est interrompue par l'avenue Émile Verhaeren et l'avenue Émile Zola y aboutit.
L'artère se situe dans le quartier dit Monplaisir-Helmet, dont le plan de voiries dressé par l'ingénieur communal des Travaux Octave Houssa est approuvé en séance du Conseil communal du 03.11.1904 puis par l'arrêté royal du 21.04.1906, en même temps que ceux des trois autres nouveaux quartiers de Schaerbeek – Monrose, de Linthout et de la Vallée Josaphat. L'artère est ouverte en 1907-1908.
Dénommée rue Albert Giraud en séance du Collège communal du 13.02.1906, l'artère devient une avenue par décision du Collège du 19.11.1907. Albert Giraud (Louvain, 1860 – Schaerbeek, 1929), de son vrai nom Marie Émile Albert Kayenbergh, est un écrivain belge d'expression française. Poète, il fut l'un des représentants du courant parnassien et cofonda la revue La Jeune Belgique. Il habita à Schaerbeek, au no4 de la rue Vanderlinden puis au no34 de la rue Henri Bergé.
Principalement résidentielle, l'artère compte également quelques bâtiments à vocation industrielle ou commerciale s'étendant largement en intérieur d'îlot. Plusieurs maisons comprennent en outre un atelier arrière. L'avenue est majoritairement bâtie entre 1906 et 1915, de maisons bourgeoises ou de rapport, principalement de style éclectique. De ce style, pointons les nos28 (1910), 30 (1911 pour le peintre Julien Stappers), 42 (architecte P. Collart, 1906), 43 (1906), 45 (architecte P. Demoulin) et 47 (architecte J. Teughels), 72 (1913), ainsi que 89 et 91 (1912). Certaines habitations sont plus ou moins mâtinées d'Art nouveau, telle l'enfilade des nos9 à 15 (voir ces numéros), les trois premières maisons conçues par l'architecte Frans Hemelsoet. Citons également des immeubles d'inspiration néo-Renaissance (voir no97) ou Beaux-Arts (voir nos22 et 41).

Entre 1920 et 1937 sont bâtis des maisons et immeubles de rapport de styles éclectique tardif, Beaux-Arts ou Art Déco. De ce dernier style, citons les nos70 (architecte J. Teughels, 1928) et 111 (architecte Jacques Leclercq, 1932). Quelques immeubles modernistes, tel le no64 (architecte A. Cornut, 1933), sont également construits durant cette période, ainsi que dans les années 1950 et 1960.
Plusieurs édifices sont dus à l'architecte Joseph Diongre, qui conçoit en style Beaux-Arts la maison-atelier du peintre Privat Livemont (voir no93). Il dessine aussi un ensemble de deux maisons aux nos90-92 et 94 (voir ces numéros) et établit son bureau à ce dernier numéro. Deux autres architectes s'installèrent dans l'avenue: Émile Henry au no22 et Guillaume Veldeman au no97 (voir ces numéros). Veldeman conçoit plusieurs bâtiments de l'artère (voir nos15, 84, 95, 97, 103), tout comme l'architecte Jean Teughels (voir nos67, 105, 107). Enfin, signalons les nombreux panneaux de sgraffites dus à Paul Cauchie ornant plusieurs façades de l'avenue, notamment les nos9, 13, 28 et 101 (voir les nos9, 13 et 101).
Sources
Archives
ACS/Urb. 28: 10-28; 30: 10-30; 42: 10-42; 43: 10-43; 64: 10-64; 70: 10-70; 72: 10-72; 89, 91: 10-85-87; 111: 10-111.
ACS/TP Dénomination des rues II.
Ouvrages
28: ARIJS, H., Paul Cauchie (1875-1952): tussen feit en fictie. Biografische aanzet: beginjaren en carrière als decorateur-entrepreneur tijdens de art-nouveauperiode (mémoire de licence Histoire de l'Art et Archéologie), 3 vol., VUB, Bruxelles, 2010-2011, catalogue (vol. 3), cat. 30, pp. 54-55.
BERTRAND, L., Schaerbeek depuis cinquante ans. 1860-1910, Librairie de l'Agence Dechenne, Bruxelles, 1912, p. 59.
DEBOURSE, X., Schaerbeek. Parcours d'Artistes, Arobase Édition, Bruxelles, 2009, pp. 52-53.
DENHAENE, G., Réveil littéraire et artistique. Schaerbeek 1880-1930, Atelier Ledoux Éditions, Bruxelles, 1998, pp. 28-30.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Bruxelles, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 7 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.
Cartes / plans
HOUSSA, O., Plan no3. Aménagement des quartiers Mon Plaisir et Helmet, 11.04.1904 (ACS/TP).
Sites internet
Petites histoires des rues de Schaerbeek
ACS/Urb. 28: 10-28; 30: 10-30; 42: 10-42; 43: 10-43; 64: 10-64; 70: 10-70; 72: 10-72; 89, 91: 10-85-87; 111: 10-111.
ACS/TP Dénomination des rues II.
Ouvrages
28: ARIJS, H., Paul Cauchie (1875-1952): tussen feit en fictie. Biografische aanzet: beginjaren en carrière als decorateur-entrepreneur tijdens de art-nouveauperiode (mémoire de licence Histoire de l'Art et Archéologie), 3 vol., VUB, Bruxelles, 2010-2011, catalogue (vol. 3), cat. 30, pp. 54-55.
BERTRAND, L., Schaerbeek depuis cinquante ans. 1860-1910, Librairie de l'Agence Dechenne, Bruxelles, 1912, p. 59.
DEBOURSE, X., Schaerbeek. Parcours d'Artistes, Arobase Édition, Bruxelles, 2009, pp. 52-53.
DENHAENE, G., Réveil littéraire et artistique. Schaerbeek 1880-1930, Atelier Ledoux Éditions, Bruxelles, 1998, pp. 28-30.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Bruxelles, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 7 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.
Cartes / plans
HOUSSA, O., Plan no3. Aménagement des quartiers Mon Plaisir et Helmet, 11.04.1904 (ACS/TP).
Sites internet
Petites histoires des rues de Schaerbeek