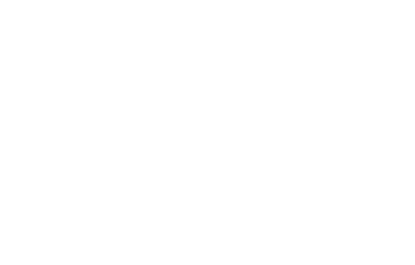Recherches et rédaction
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
La ch. d'Alsemberg part du carrefour de la Barrière de Saint-Gilles, suivant un axe nord-sud, pour se diriger vers le village d'Alsemberg, dont elle porte le nom. Ses maisons jusqu'aux nos 139 et 156 sont situées sur le territoire saint-gillois. La chaussée traverse ensuite les communes de Forest, Uccle, Linkebeek et Beersel.
La carte de Jacques Van Deventer (v. 1550-1554) figure un long chemin rural au tracé sinueux s'étirant de la porte de Hal, vers le sud. C'est probablement en partie sur l'assiette de cette voie que le 1er tronçon de la ch. d'Alsemberg, situé entre la Barrière de Saint-Gilles et Calevoet, est créé entre 1726 et 1730 environ. En 1740, la chaussée est prolongée jusqu'à Alsemberg.
Au début, comme le montre une carte de 1766 (voir Vernier, L., 1949, p. 109), la chaussée d'Alsemberg constitue un seul et même chemin avec la partie de l'act. ch. de Waterloo située dans son prolongement, comprise entre la porte de Hal et l'act. Barrière.
La ch. d'Alsemberg devient route provinciale en 1830. L'Atlas cadastral de 1837 la figure vierge de constructions. Sur un plan de Victor Besme du mil. du XIXe s. (voir Vernier, L., 1949, p. 42) apparaissent les 1res constructions, assez éparses.
Chaussée d'Alsemberg (Collection cartes postales Dexia Banque, v. 1930).
Les trois 1ers permis de bâtir conservés remontent à 1853, 1862 et 1863. La majorité des constructions ne voit toutefois le jour que durant le dern. tiers du XIXe s., suite au pavage de la chaussée en 1870 suivi du placement des égouts en 1872. Les 1res constructions sont destinées à l'habitation.
À partir de 1895, la chaussée est empruntée par le tramway électrique reliant la gare du Midi à Uccle-Globe. À partir de cette époque, elle connaît une intense activité commerçante. Les r.d.ch., transformés en devanture, connaissent de nombreuses modifications au cours du temps, principalement au cours des années 1940 à 1970, époque florissante pour le commerce. Celui-ci connaît, ces dern. décennies, une certaine perte de vitesse.
La majorité des façades relève du style néoclassique, comme aux no 5 (1863), no 11 (1864), nos 14 et 16 (1853), des maisons jumelles particulièrement anc. présentant de sobres et larges façades, no 32 (1896), no 46-46a (1902), no 57-57a (1882) à l'angle de l'av. des Villas, nos 81, 83 et 85, trois maisons jumelles (entrepreneur Hector Deprez et fils, 1902), nos 92 et 94 (1904), no 118 (1875), no 120 (1875), no 122 (1899) avec une devanture à carreaux de céramique (arch. André Watteyne, 1941). Dans la même veine, diverses maisons sont érigées à des dates indéterminées : les nos 7, 22, 53 et 55, des maisons jumelles, No 68-70, no 86, no 88, no 91, exhaussé d'un niveau, dont la devanture date de 1932 (arch. Maurice Vander Elst), ainsi que le no 154.
Bon nombre de ces maisons néoclassiques sont mal conservées. Le no 90 (1875) est déroché. D'autres voient leur enduit remplacé par un parement de briquettes, comme les no 3 (1863), No 8-10 (1873), nos 11 et 13 (1864), No 15 (1897), No 20 (1864), no 24 (1872) briqueté en 1942, conserve sa devanture de 1908, no 26 (1872), No 28 (1896), No 47 (1875) en 1941, No 50 (1901), No 62 (1862), no 74-74a (1871), No 80 (arch. Jean-Baptiste Mesmaeker, 1887), no 95 (1892), no 116 (1876), no 124 (1899), no 150-152 (1898) en 1947 et 156 (1898). Les dates de permis de bâtir de bon nombre de ces maisons néoclassiques recouvertes de briquettes ne sont pas connues aux nos 6, 12, 19 exhaussé en 1949, 33-35, 39 à 45 act. remembrés en un seul bâtiment, 49, 51, 58, 59, 61, 63 et 82. D'autres façades sont ré-enduites à faux-joints, comme aux no 21, no 64 et no 73, tous deux mansardés, l'un en 1934, l'autre en 1953, no 76 (1871), no 79 (1892), no 84 (1871). Des maisons aujourd'hui dotées de fenêtres en bandeaux à la manière moderniste révèlent encore discrètement leur origine néoclassique par la présence de leur anc. corniche, comme aux no 9 (1864), no 60, no 78, no 93 (1892). Les nos 69 et 71 (tous deux de 1875) sont rhabillés en style éclectique.
À la charnière des XIXe et XXe s., de nombreuses maisons éclectiques à façade polychrome, pour la plupart de composition asymétrique, voient le jour, tels les no 18 (arch. Pierre de Gieter, 1914), no 96-96a et r. de Savoie 59 (arch. Jean Maelschalck, 1903), no 101 (1913), no 126 (1899). Le no 130-132, teinté de style néoclassique (arch. A. Sarot, 1899) forme l'angle de la r. Antoine Bréart, où il porte le no 153-155.
Ces habitations sont parfois construites en ensemble, comme les nos 115 à 121, quatre maisons éclectiques de 1888 agencées en miroir de deux fois deux maisons semblables. L'ensemble est aujourd'hui déparé par l'exhaussement du no 115 en 1928 et du no 117 en 1935, ainsi que par un parement de briquettes au no 121 en 1953. Aux nos 140 à 146, ensemble de maisons de 1903, relativement bien conservé. Ses r.d.ch. sont convertis en commerces, celui du no 142 en 1938 (arch. A. Foidart et P. Van Eyck), celui no 146 en 1935 (arch. Henri De Saedeleer), ceux des nos 140 et 144 par l'arch. Robert Herpain en resp. 1937 et 1936. La devanture du no 144, bien conservée, est parée de carrelage vert et noir, act. peint en blanc ; à dr., porte d'entrée de style paquebot.
D'autres devantures commerciales intéressantes sont conservées çà et là. Au no 17 (1875), une devanture revêtue de carreaux de faïence (arch. Charles De Wys, 1938). Au No 26, devanture Art Déco établie en 1933 par l'arch. Louis Deltombe. Au no 30 (1896), devanture moderniste en mosaïque verte, avec baie d'imposte portant l'inscription « Spécialités orthopédiques » (bureau d'arch. Sinceritas, 1947). Le no 54-54a (voir ce n°), à l'angle de la r. Adolphe Demeur, présente un r.d.ch. commercial dès 1894.
Le style Art Déco, plutôt concentré sur le tronçon vers la pl. Albert, est adopté pour la modernisation de maisons plus anc. : au no 37, façade fin XIXe s., rhabillée par l'arch. Pierre De Gieter en 1929 ; au No 56 (entrepreneur Jean-Baptiste Carsoel, 1863), nouvel enduit de style Art Déco en 1928 par l'arch. Pierre Netels ; au no 105, façade fin du XIXe s. rhabillée en 1935. Aux nos 135 et 137-137a, l'entrepreneur Gabriel Duhoux fait construire en 1924 deux immeubles identiques de style Art Déco dont les commerces ont été modernisés resp. en 1964 et 1965.
La chaussée comporte également quelques immeubles de rapport. Le plus anc. est édifié au no 36-36a-38 en 1911 et exhaussé d'un niveau en 1924. Cependant, la plupart des immeubles de rapport sont construits après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont pour la plupart de petite taille : environ 7 m de large sur trois à cinq niveaux, comme aux no 4 (1946), 23-25 (1951), 34 (1938), 67 (1967), 110 (arch. Robert Swaelens, 1961), 112 (1931) de style éclectique teinté d'Art Déco, 131 (arch. Pierre De Gieter, 1926) présentant une devanture moderne en aluminium, 133 (arch. Pierre De Gieter, 1924), 135 et 137 (entrepreneur Gabriel Duhoux, 1924), no 136 (arch. Robert Lemaire, 1945) avec devanture commerciale remplacée en 1978 (arch. Robert Nève), no 138 (arch. Jean Tombeur, 1961).
Notons également diverses constructions récentes. Le no 114 est dessiné par l'arch. Jean-Pierre Debaise en 1990 à la place d'une maison datant de 1877. Le no 123 (1862) est agrandi et exhaussé d'un niveau en 1929 par l'arch. Georges Servais. En 1981, le r.d.ch. et la façade sont réaménagés pour l'établissement d'une banque.
Sources
Archives
ACSG/Urb. 3 : 176 (1863) ; 4-6 : 164 (1946) ; 5 : 240 (1863) ; 8-10 : 1895 (1873) ; 9 : 269 (1864) ; 11 : 269 (1864) ; 14 et 16 : 3675 (1853) ; 15 : 982 (1897) ; 17 : 3256 (1875) ; 18 : 6/4 (1853) ; 19 : 19 (1949) ; 20 : 309 (1864) ; 23, 25 : 123 (1951) ; 24, 26 : 648 (1870), 26 : 51 (1933) ; 28, 30, 32 : 611 (1896) ; 30 : 106 (1947) ; 34 : 319 (1938) ; 36-36a-38 : 150 (1911), 366 (1926) ; 37 : 327 (1929), 130 (1941) ; 44 : 21 (1905) ; 46 : 202 (1902) ; 47 : 3351 (1875) ; 50 : 166 (1901) ; 56 : 188 (1863), 324 (1928) ; 57-57a : 203 (1882) ; 62 : 127 (1862) ; 64 : 6 (1934) ; 69 : 3300 (1875) ; 71 : 3301 (1875) ; 73 : 157 (1953) ; 74-74a : 1097 (1871) ; 76 : 1230 (1871) ; 79 : 310 (1892) ; 80 : 2125 (1873) ; 81, 83, 85 : 392 (1902) ; 84 : 1229 (1871) ; 90 : 2821 (1875) ; 91 : 27 (1932) ; 92, 94 : 145 (1904) ; 93 : 3077 (1892) ; 95 : 2955 (1892) ; 96-96a : 183 (1903) ; 101 : 316 (1913) ; 105 : 75 (1935) ; 110 : 42 (1961) ; 112-114 : 1347 (1877) ; 114 : 77 (1990) ; 115 à 121 : 1844 (1888), 251 (1928), 82 (1935), 197 (1953) ; 116 : 3890 (1876) ; 118 : 3160 (1875), 123 (1961) ; 120 : 3221 (1875) ; 122, 124 : 1737 (1899) ; 123 : 911 (1862), 489 (1929), 7 (1981) ; 126-128 :1737 (1899) ; 130-132 et r. Antoine Bréart 153-155 : 1569 (1899) ; 135-137 : 105 (1924), 133 (1924), 71 (1964), 46 (1965) ; 136 : 178 (1863), 17 (1978) ; 138 : 50 (1961) ; 140 à 146 : 95 (1903) ; 140-140a : 231 (1937) ; 142-142a : 268 (1938) ; 144-144a : 256 (1936) ; 146 : 209 (1935) ; 150-152 : 1153 (1898), 203 (1947) ; 154, 156 : 149 (1898).
Collection cartes postales Dexia Banque.
Ouvrages
Saint-Gilles Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU asbl, Bruxelles, 1988, p. 35.
VERNIERS, L., Histoire de Forest-lez-Bruxelles, éd. De Boeck, Bruxelles, 1949, pp. 105-111, 212.
Périodiques
DONS, R., « Les voies de communication à Obbrussel-Saint-Gilles jusqu'au début de 1840 (2e partie) », Le Folklore brabançon, 272, 1991, pp. 341-345.