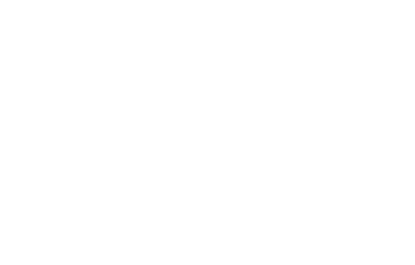Recherches et rédaction
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaireCette avenue, qui débute avenue de l'Hippodrome et aboutit square de la Croix-Rouge, longe la rive gauche des étangs d'Ixelles.
Tout comme l'avenue des Éperons d'Or, elle reprend approximativement le tracé de l'ancien Losgat, un chemin qui reliait l'abbaye de La Cambre à l'actuelle place Eugène Flagey (ancien village d'Ixelles). Ce chemin, par lequel s'opérait le transport du bois de la forêt de Soignes vers Bruxelles, fut empierré en 1700 par l'abbesse Isabelle Claire de Grobbendonck et devint dès lors chemin puis chaussée de La Cambre.
Son tracé actuel fut ratifié par l'arrêté royal du 22.08.1873 fixant le Plan d'expropriation par zones pour l'aménagement des abords des étangs et pour l'ouverture de plusieurs rues aboutissant à l'avenue Louise, à la chaussée de Boondael, à la place Sainte-Croix et à l'ancienne abbaye de la Cambre (par l'inspecteur voyer des faubourgs de Bruxelles Victor Besme et le directeur des Travaux publics d'Ixelles Louis Coenraets). Les travaux de voirie et d'appropriation des étangs furent exécutés par la Société de l'Avenue Louise –propriétaire des terrains situés en contrebas du rond-point de l'avenue Louise– suite à une convention conclue avec la Ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles (à laquelle ressortissait l'essentiel des terrains depuis 1871).
Le pan coupé à l'angle de l'avenue de l'Hippodrome fut par la suite réduit de quelques mètres afin d'élargir l'emprise de la voirie, et ce selon un plan modificatif fixé par arrêté royal le 17.06.1910.
C'est dans le cadre des travaux urbanistiques des années 1870 que l'avenue reçut sa dénomination actuelle. Son nom évoque la bataille des Éperons d'Or qui se déroula le 11.07.1302 dans la plaine de Groeningen, près de Courtrai. Durant cette journée, les milices communales flamandes, les Klauwaerts («Hommes de griffes»), bénéficiant de l'aide des Brabançons et des Namurois venus leur prêter main-forte, battirent les chevaliers du roi de France Philippe IV le Bel. Les troupes victorieuses dépouillèrent de leurs éperons dorés les chevaliers morts dans la bataille et les ramenèrent comme trophées. Ceux-ci ornèrent l'église Notre-Dame de Courtrai avant d'être récupérés par la France et installés à Dijon.
À l'instar de l'ensemble des rues du quartier des Étangs, l'avenue conserve l'essentiel de son architecture originelle du début du XXe siècle. Ce bâti consiste en une remarquable suite de maisons bourgeoises dominée par l'éclectisme et dont les façades sont précédées d'une servitude de non bâtisse de huit mètres permettant l'aménagement d'un jardinet participant à la conception paysagère et pittoresque des étangs, conformément à la convention signée en 1873 entre la commune d'Ixelles et la Société de l'Avenue Louise.
Parmi ces maisons se détachent l'ensemble Art nouveau de l'architecte Ernest Blérot (voir nos15, 16) ainsi que la remarquable façade de style néo-Renaissance flamande de l'ancienne maison personnelle de l'historien Guillaume Des Marez (Courtrai, 1870–Bruxelles, 1931), auteur du célèbre Guide illustré de Bruxelles, Monuments civils et religieux (Bruxelles, 1958) et dont l'action permit la sauvegarde et la restauration de l'abbaye de La Cambre, après la Seconde Guerre mondiale (voir n°11). Les façades des maisons sises aux nos20 et 21 affichent quant à elles le style gothique (voir ces numéros). Construites selon une demande de permis introduite en 1875 par la Compagnie immobilière de Belgique (société mère de la Société de l'Avenue Louise), ces maisons comptent parmi les plus anciennes du quartier des Étangs.
L'architecte Pierre De Groef fut amené à construire plusieurs maisons dans l'avenue, dont sa maison personnelle à la façade Beaux-Arts, au n°36 (voir ce numéro; voir également les nos12, 24, 31, 34, 35).
Sources
Archives
ACI/TP Historique des rues (1925).
ACI/TP 188.
Ouvrages
DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Bruxelles, 2007.
GUILLAUME, A., MEGANCK, M., et al., Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles:15 Ixelles, Bruxelles, 2005, pp.64, 116, 118.
Guillaume Des Marez. Courtrai 1870–Ixelles 1931 (Catalogue d'exposition), Cercle d'histoire d'Ixelles–Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, Bruxelles, 1982.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Ixelles-Village et le quartier des Étangs, Commune d'Ixelles, Bruxelles, 1998 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 3).
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Bruxelles, 1990, pp.81-88.
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 1994 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 10).
Périodiques
SEGERS, J., «Un Ixellois d'adoption: Guillaume Des Marez», Mémoire d'Ixelles, 3, 1981, pp.15-19.