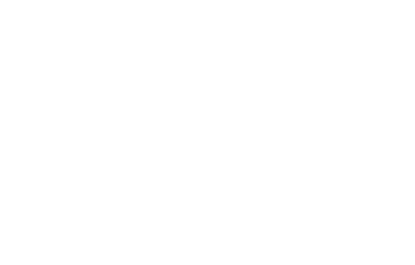Recherches et rédaction
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaireLongue artère au parcours sensiblement parallèle à celui de la chaussée d’Alsemberg, la rue Marconi relie l’avenue Albert à l’avenue Molière. Elle divise en deux tronçons la rue Vanden Corput et les rues du Zodiaque et É. Branly y aboutissent.
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la rue Marconi résulte de l’aménagement d’un très ancien chemin vicinal dénommé Groenen weg, pavé vers 1860. Bien que le réaménagement de ce chemin soit prévu dans le Plan général d’alignement et d’expropriation par zones du quartier de Berkendael (Ir. Désiré Van Ouwenhuysen), initié par Georges Brugmann et fixé par arrêté royal le 12.07.1902, celui-ci n’est effectivement redressé et élargi que dans le cadre d’un nouveau Plan d’élargissement de la rue Verte [actuelle rue Marconi] et de la rue du Chat [actuelle rue Rodenbach], fixé par arrêté royal le 24.06.1904.
![[i]Plan d’élargissement de la rue Verte et de la rue du Chat[/i], fixé par arrêté royal le 24.06.1904, ACF/TP dossier 41.](/medias/500/streets/11900122_Z02.jpg)
Anciennement dénommée rue Verte, l’artère est rebaptisée rue Marconi le 25.02.1915 en hommage au physicien italien Guglielmo Marconi (1874-1937), spécialiste de la télégraphie sans fil (Prix Nobel en 1909).
Dès la fin du XIXe siècle, le secteur des rues Marconi et Rodenbach apparaît comme une petite «enclave industrielle» dans la commune, avec de petites entreprises et des ateliers. Cette particularité s’explique vraisemblablement en raison de la proximité de la chaussée d’Alsemberg, important axe routier, ainsi que par la moins-value qui constitue la proximité des hôpitaux et des prisons de Saint-Gilles et de Forest. Aujourd’hui, rares sont les infrastructures industrielles à avoir été conservées.
À l’instar de la rue Rodenbach qui lui est parallèle, la rue Marconi se caractérise par une architecture principalement érigée entre 1900 et 1910, composée d’immeubles à logements multiples, de logements ouvriers et de maisons d’habitation construites pour la classe moyenne.

Les logements ouvriers les plus anciens datent de la fin du XIXe siècle. Ils se situent à hauteur des nos67 à 81 (le n°71 profondément modifié): une série de petites maisons de deux travées et deux niveaux à la façade d’inspiration classique très sobre, construites entre 1893 et 1902 pour un dénommé F. De Hollander. Subsiste également de cette époque l’enfilade de petites habitations situées aux nos102 à 112, de 1896, et qui se distingue également par son implantation hors alignement.

L’essentiel du bâti actuel de l’artère s’érige durant la première décennie du XXe siècle. Il se compose de petits immeubles de rapport de style éclectique comme au n°56 (1910) et n°52-54 (architecte Arthur Nelissen, 1909) et de modestes maisons unifamiliales construites pour la classe moyennes et prenant l’apparence d’une maison bourgeoise comme au n°120 (architecte Fernand Discailles, 1904) ou au n°90 dont la façade d’inspiration Art nouveau a malheureusement été défigurée par le remplacement de la menuiserie d’origine (architecte Georges Cochaux-Segard, 1909). Citons également l’ensemble de petites maisons éclectiques (nos109 à 121) construites en 1908 par l’entrepreneur Demey et jouxtant La Magnéto Belge (voir n°123-125-127), bâtiment industriel construit au début des années 1940 par l’architecte Léon Guiannotte, qui avait collaboré quelques années plus tôt avec André Watteyne à la construction de l’église Saint-Augustin, place de l’Altitude Cent (voir cette église).
Parmi ce bâti se distinguent les remarquables immeubles de logements plurifamiliaux construits en 1901-1903 par la Société Anonyme des Habitations à Bon Marché de l’Agglomération Bruxelloise, et dont les plans furent confiés à des architectes de renom: Léon Govaerts (voir n°32), Émile Hellemans (voir n°34-36) et Henri Jacobs qui était également l’architecte attitré du Foyer Schaerbeekois (voir n°38-42). Si tous trois conçoivent des bâtiments différents d’un point de vue architectural, il apparaît clairement que ces derniers ont été pensés comme un seul et même ensemble, comme en témoigne la grande cour commune.
Ces immeubles font partie d’un vaste projet de construction de logements sociaux (voir également rue Rodenbach nos8 à 12, nos14 à 22 et nos27 à 35 ainsi que rue Berkendael nos11 à 15) sur des terrains acquis par la Société Anonyme des Habitations à Bon Marché dès l’élaboration du plan d’aménagement du quartier Berkendael, dans le cadre d’une convention signée avec le promoteur G. Brugmann (disposition reprise dans l’arrêté royal de 1902). Ces acquisitions s’inscrivent dans le contexte de la nouvelle urbanisation des faubourgs de Bruxelles et la nécessité de reloger les populations ouvrières expulsées de leur logement par les grands travaux d’assainissement et d’aménagement urbanistique entrepris dans le Pentagone.
C’est dans un quartier en plein développement que la Compagnie Intercommunale des Eaux de Bruxelles décide d’implanter, début 1900, un château d’eau afin d’assurer les besoins en eau à la population et à l’ensemble des petites industries (voir n°167).
Au-delà de la rue du Zodiaque, tout le côté pair de la rue Marconi est occupé par des bâtiments faisant partie du centre hospitalier Molière-Lonchamp (voir avenue Molière n°32-34).
Signalons enfin qu’au n°118, une plaque commémorative rappelle que vécut à cette adresse Albert Ayguesparse (1900-1996), poète et écrivain belge qui fut membre de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.
Sources
Archives
ACF/TP
dossier 41 (Rue Marconi-Rue Rodenbach).
ACF/TP dossier 12 (Quartier Brugmann).
ACF/Urb. 48: 8405 (1924),
23647 (2005-2006); 52-54:
5027 (1909), 19061 (1967); 56:
5306 (1910); 67: 882
(1893), 8772 (1925), 21275 (1991), 21283; 69: 882 (1893), 15489 (1950); 71: 882 (1893), 5784; 73: 882 (1893), 6319 (1913); 75: 1495 (1893), 5714 (1911), 21882 (1995); 77: 1495 (1899), 11792 (1932),
23242 (2003-2004), 25545 (2013); 79:
1968 (1902), 4791 (1909); 81:
1713 (1901), 8276 (1924), 8878 (1926), 22457 (1999); 90: 4947 (1909); 102
à 112: 66 (1896); 102:
8341 (1924), 8355 (1924), 20953; 104:
8383 (1924); 106: 8307
(1924); 108: 8483
(1925), 10531 (1929), 20389, 24246 (2008); 109 à 121: 4774 (1908); 110: 7470 (1922), 13617 (1938); 111: 4737 (1908); 112:
4023, 8193 (1924); 113:
8910 (1926); 115: 9740
(1928), 15478 (1950); 117:
9377 (1927), 13417 (1937); 118:
3464 (1904), 12114 (1933); 119:
13416 (1937), 21059; 120:
3446 (1904), 8085 (1924), 23295 (2004).
Ouvrages
D’OSTA, J., Dictionnaire historique des
Faubourgs de Bruxelles, éd. Paul Legrain, 1989. (Réédité aux Editions Le
Livre en 1996).
DEL MARMOL, B., L’avenue Molière et le
quartier Berkendael, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles, 2002 (Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, 33).
GAIARDO, L., Société Coopérative du
Logement de l’Agglomération bruxelloise. Centième anniversaire, IGEAT-ULB,
2000, pp. 7-9.
VERNIERS, L., Histoire de Forest Lez Bruxelles,
Bruxelles, 1949.
VAN LIL, A., Wegwijs te Vorst, Brussel, 1981, p. 53.
SMETS, M., L’avènement de la
cité-jardin en Belgique. Histoire de l’habitat social en Belgique de 1830 à
1930, Bruxelles-Liège, 1979, p. 56.