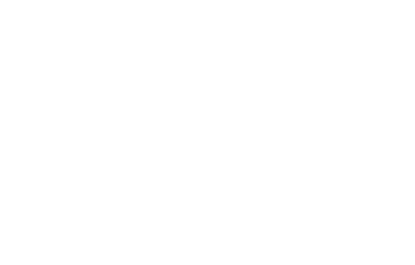Recherches et rédaction
1993-1995
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
Reliant aujourd'hui la pl. Saint-Pierre à la pl. du Quatre Août.
Elle suit approximativement le tracé d'un anc. chemin, le Grote Scheidhaag, qui comprenait l'act. r. de l'Escadron et aboutissait r. du Bémel, sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. Le chemin traversait un ensemble de terrains appartenant aux Hospices de Bruxelles qui en demandèrent la suppression en 1865. Plusieurs fours à briques étaient exploités le long du chemin.
La rue est décrétée en 1892, avant que la ligne de chemin de fer ne la divise en deux. La 1re partie est retracée en 1899, lors de la création de la pl. Saint-Pierre. Un pont, construit au-dessus du chemin de fer, relie les deux sections en 1910. Quelques maisons sont encore expropriées en 1930 pour apporter des modifications légères à l'alignement.
Le ler tronçon (de la pl. Saint-Pierre à la r. de la Gare) conserve encore quelques habitations d'inspiration néoclassique, construites entre 1880 et 1910, aux façades enduites, de deux ou trois niveaux et généralement deux travées inégales. La plupart d'entre elles ne présentent plus leur aspect d'origine, les ouvertures ayant souvent été réorganisées et la façade recouverte par des briquettes de parement. Il reste cependant quelques exemples presque intacts tels les nos 9 (1902), 21 (1899-1900, qui formait un ensemble avec le no 19, considérablement transformé en 1967) ou 35 (1889, r.d.ch. transformé en 1928). Une autre construction ayant perdu son aspect d'origine, de style éclectique, est le no 8-10 (1908, arch. Franz D'OURS et Charles NEIRYNCK). Le tronçon compte également quelques constructions à fonction industrielle comme les nos 22 à 28 (1914-1915 et 1933, ensemble comprenant, à l'origine, un bâtiment d'habitation, des écuries et des entrepôts à charbon) ou 23 à 29 (1958, arch. Pierre PEEMANS) ainsi que des immeubles à logements multiples comme les nos 32 à 36 (1924).
Le 2e tronçon ne présente plus d'habitations que du côté impair, le côté pair ayant été entièrement démoli pour faire place au cours Saint-Michel. Il compte encore quelques maisons de la fin du XIXe s. d'inspiration néoclassique, tels les nos 71 (1877), 81 (1898, formait un ensemble avec le no 79, recouvert de briquettes en 1955) ainsi que des habitations traditionnelles du début du XXe s., de style éclectique ou influencées par l'Art nouveau comme le no 75 (1913) ou l'ensemble nos 111 à 119 (1903 et 1906, nombreuses transformations, une chapelle provisoire établie au no 113 abrite le culte entre 1925 et 1928, en attendant l'achèvement de la nouvelle église Notre-Dame du Sacré-Cœur). L'ensemble de quatre maisons, nos 121 à 127, est bâti en 1901 d'après les plans de l'arch. Jean BERDEN. Le no 129, élevé au début du XXe s., est signé par l'arch. ALBERTUCCIO. Quelques constructions affichent une influence Art Déco comme le no 141 (1930, arch. Gaston DONY) ou moderniste tel le no 149 (1936, arch. L. HUYBERECHTS). Quatre immeubles à appartements, construits pour le Foyer etterbeekois, font partie d'un grand ensemble aménagé entre la r. Jean Massart, la r. du Fort de Boncelles et l'av. Édouard de Thibault (Nos 103 et 105, deux immeubles construits sur un schéma symétrique en 1923 selon les plans de l'arch. Édmond ABS, chacun de quatre niveaux et cinq travées dont la centrale en léger ressaut, sous bâtière ; nos 107-107A et 109-109A, deux immeubles construits, aux coins de la r. Fort de Boncelles, en 1922 d'après les plans de l'arch. Arthur FRANCOIS, chacun de quatre niveaux et dix travées sous une toiture mansardée, les quatre en brique et simili-pierre blanche).
Elle suit approximativement le tracé d'un anc. chemin, le Grote Scheidhaag, qui comprenait l'act. r. de l'Escadron et aboutissait r. du Bémel, sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. Le chemin traversait un ensemble de terrains appartenant aux Hospices de Bruxelles qui en demandèrent la suppression en 1865. Plusieurs fours à briques étaient exploités le long du chemin.
La rue est décrétée en 1892, avant que la ligne de chemin de fer ne la divise en deux. La 1re partie est retracée en 1899, lors de la création de la pl. Saint-Pierre. Un pont, construit au-dessus du chemin de fer, relie les deux sections en 1910. Quelques maisons sont encore expropriées en 1930 pour apporter des modifications légères à l'alignement.
Le ler tronçon (de la pl. Saint-Pierre à la r. de la Gare) conserve encore quelques habitations d'inspiration néoclassique, construites entre 1880 et 1910, aux façades enduites, de deux ou trois niveaux et généralement deux travées inégales. La plupart d'entre elles ne présentent plus leur aspect d'origine, les ouvertures ayant souvent été réorganisées et la façade recouverte par des briquettes de parement. Il reste cependant quelques exemples presque intacts tels les nos 9 (1902), 21 (1899-1900, qui formait un ensemble avec le no 19, considérablement transformé en 1967) ou 35 (1889, r.d.ch. transformé en 1928). Une autre construction ayant perdu son aspect d'origine, de style éclectique, est le no 8-10 (1908, arch. Franz D'OURS et Charles NEIRYNCK). Le tronçon compte également quelques constructions à fonction industrielle comme les nos 22 à 28 (1914-1915 et 1933, ensemble comprenant, à l'origine, un bâtiment d'habitation, des écuries et des entrepôts à charbon) ou 23 à 29 (1958, arch. Pierre PEEMANS) ainsi que des immeubles à logements multiples comme les nos 32 à 36 (1924).
Le 2e tronçon ne présente plus d'habitations que du côté impair, le côté pair ayant été entièrement démoli pour faire place au cours Saint-Michel. Il compte encore quelques maisons de la fin du XIXe s. d'inspiration néoclassique, tels les nos 71 (1877), 81 (1898, formait un ensemble avec le no 79, recouvert de briquettes en 1955) ainsi que des habitations traditionnelles du début du XXe s., de style éclectique ou influencées par l'Art nouveau comme le no 75 (1913) ou l'ensemble nos 111 à 119 (1903 et 1906, nombreuses transformations, une chapelle provisoire établie au no 113 abrite le culte entre 1925 et 1928, en attendant l'achèvement de la nouvelle église Notre-Dame du Sacré-Cœur). L'ensemble de quatre maisons, nos 121 à 127, est bâti en 1901 d'après les plans de l'arch. Jean BERDEN. Le no 129, élevé au début du XXe s., est signé par l'arch. ALBERTUCCIO. Quelques constructions affichent une influence Art Déco comme le no 141 (1930, arch. Gaston DONY) ou moderniste tel le no 149 (1936, arch. L. HUYBERECHTS). Quatre immeubles à appartements, construits pour le Foyer etterbeekois, font partie d'un grand ensemble aménagé entre la r. Jean Massart, la r. du Fort de Boncelles et l'av. Édouard de Thibault (Nos 103 et 105, deux immeubles construits sur un schéma symétrique en 1923 selon les plans de l'arch. Édmond ABS, chacun de quatre niveaux et cinq travées dont la centrale en léger ressaut, sous bâtière ; nos 107-107A et 109-109A, deux immeubles construits, aux coins de la r. Fort de Boncelles, en 1922 d'après les plans de l'arch. Arthur FRANCOIS, chacun de quatre niveaux et dix travées sous une toiture mansardée, les quatre en brique et simili-pierre blanche).
Sources
Archives
ACEtt./ Indic Gén. 51963 (1877), - (1889), 8163 (1898), 9756 (1899), TP 10742 (1900), 12112 (1901), 13813 (1902), 15005 (1903), 18901 (1906), 794 (1908), 5509 (1913), 291 (1914), 597 (1914-1915), no d'ordre 1105 (1923), TP 4820, 5195 (1924), 6949 (1925), 2116, 3203 (1928), 6030 (1930), 3364 (1933), 2630 (1936), 2867 (1937), 741 (1939), Reg. d'entrée 1876 (1955), 793 (1958), 1207 (1961), 2040 (1967).
AR 29.09.1892, 26.12.1898.
Archives Foyer Etterbeekois/Dossier r. de la Grande Haie, 1922.
CC 16.07.1863, 26.01.1865, 17.04.1899.
RPV 1909, p. 198, 1918, p. 502.
RC 1896, p. 70, 1897, p. 84, 1938, p. 65, 1939, p. 74, 1940, p. 57.
STP, f° 80.
Ouvrages
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Bruxelles, 1981, p. 106.
AR 29.09.1892, 26.12.1898.
Archives Foyer Etterbeekois/Dossier r. de la Grande Haie, 1922.
CC 16.07.1863, 26.01.1865, 17.04.1899.
RPV 1909, p. 198, 1918, p. 502.
RC 1896, p. 70, 1897, p. 84, 1938, p. 65, 1939, p. 74, 1940, p. 57.
STP, f° 80.
Ouvrages
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Bruxelles, 1981, p. 106.