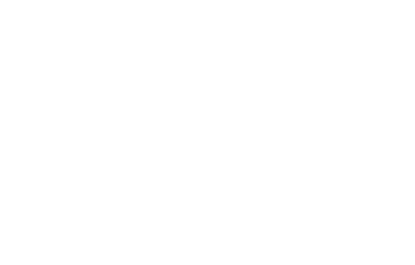Recherches et rédaction
1993-1995
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
La rue fut tracée en 1893 (AR de 1883), à l'emplacement du Broebelaerpad qui s'étendait le long du Broebelaer, en reliant la ch. de Wavre à la r. Baron Lambert. La partie entre la ch. de Wavre et l'av. d'Auderghem (à l'origine la r. du Broebelaer) fut achevée et reçut son appellation act. en 1895 (d'après L. Hap, bourgmestre d'Etterbeek en 1861).
Située le long des terrains de la famille Hap, on peut supposer que la rue fut tracée pour des motifs spéculatifs.
Le tronçon entre l'av. d'Auderghem et la r. Colonel Van Gele fut tracé dans les années 1880 (AR de 1885), la partie reliant la r. Colonel Van Gele à la pl. Saint-Pierre au déb. du XXe s. (avant 1906) ; le vieux sentier et le Broebelaer disparurent en 1885.
Son 1er tronçon est bordé d'anc. ateliers et d'entrepôts. Les ateliers furent agrandis à plusieurs reprises, e.a. en 1908, 1938, 1939 (façade r. L. Hap) et en 1947 (façade ch. Saint-Pierre).
La rue est caractérisée par des immeubles de style éclectique, parfois conçus comme un ensemble, ou d'inspiration néoclassique à façades enduites et peintes, rythmées horizontalement e.a. par des cordons, la plupart de deux, trois ou quatre niveaux et deux ou trois travées, quelques-unes avec un parement récemment rénové. Parmi les exemples les mieux conservés, les nos 8, 10, 20 à 28 de deux niveaux, construits suivant le schéma de ceux de la r. Posschier, les nos 25, 27, 39, 48, 50-52 (maisons à l'angle de la r. Richard Kips), 54, (1902, arch. A. DIERICKX), 74, 89 (1901), 90 à 94 de trois niveaux, 91, 169 (1912, arch. A. GOSSIAUX ; r.d.ch. à refends) et le no 242 (1902) ; immeubles éclectiques à façades en briques, éventuellement divisées horizontalement par des bandes, parfois conçus comme un ensemble. Remarquables sont les nos 35, 37 (No 35 avec une plaque commémorative portant l'inscription « OCTAVE RILLAERT/COMPOSITEUR/1905-1979/A HABITE ICI/DE 1958 A SA MORT »), 41 à 47 (baies sous poutrelle métallique en I), 96, 98 (1907, arch. C. COOMANS ; soubassement à bossages), les nos 109 à 117 avec devanture commerciale parfois remaniée, façades rythmées horizontalement par des bandes, quelques baies jumelées aux étages ; les nos 162 (1911), 164 (1911), 203 (1908), 205, 209 (1910, exhaussé d'un niveau en 1928), 211 (1909), 214, 235 (1911, exhaussement d'un niveau, belles baies jumelées cintrées).
Signalons quelques immeubles de l'entre-deux-guerres, tels les nos 216 (1923, arch. J. FINNÉ) et 239 (1925, arch. P. ONGENAE), et un certain nombre d'immeubles à appartements modernes, comme les nos 102 à 118 de cinq niveaux (1975, arch. J. DE MESMAEKER), construits pour Le Foyer etterbeekois, comme en témoigne l'inscription suivante : « MR. LÉON DEFOSSET DÉPUTÉ BOURGMESTRE D'ETTERBEEK A POSÉ LA 1 ERE PIERRE DE CES IMMEUBLES DU FOYER ETTERBEEKOIS LE 9.6.1976 », et les nos 198-200 (1968).
Située le long des terrains de la famille Hap, on peut supposer que la rue fut tracée pour des motifs spéculatifs.
Le tronçon entre l'av. d'Auderghem et la r. Colonel Van Gele fut tracé dans les années 1880 (AR de 1885), la partie reliant la r. Colonel Van Gele à la pl. Saint-Pierre au déb. du XXe s. (avant 1906) ; le vieux sentier et le Broebelaer disparurent en 1885.
Son 1er tronçon est bordé d'anc. ateliers et d'entrepôts. Les ateliers furent agrandis à plusieurs reprises, e.a. en 1908, 1938, 1939 (façade r. L. Hap) et en 1947 (façade ch. Saint-Pierre).
La rue est caractérisée par des immeubles de style éclectique, parfois conçus comme un ensemble, ou d'inspiration néoclassique à façades enduites et peintes, rythmées horizontalement e.a. par des cordons, la plupart de deux, trois ou quatre niveaux et deux ou trois travées, quelques-unes avec un parement récemment rénové. Parmi les exemples les mieux conservés, les nos 8, 10, 20 à 28 de deux niveaux, construits suivant le schéma de ceux de la r. Posschier, les nos 25, 27, 39, 48, 50-52 (maisons à l'angle de la r. Richard Kips), 54, (1902, arch. A. DIERICKX), 74, 89 (1901), 90 à 94 de trois niveaux, 91, 169 (1912, arch. A. GOSSIAUX ; r.d.ch. à refends) et le no 242 (1902) ; immeubles éclectiques à façades en briques, éventuellement divisées horizontalement par des bandes, parfois conçus comme un ensemble. Remarquables sont les nos 35, 37 (No 35 avec une plaque commémorative portant l'inscription « OCTAVE RILLAERT/COMPOSITEUR/1905-1979/A HABITE ICI/DE 1958 A SA MORT »), 41 à 47 (baies sous poutrelle métallique en I), 96, 98 (1907, arch. C. COOMANS ; soubassement à bossages), les nos 109 à 117 avec devanture commerciale parfois remaniée, façades rythmées horizontalement par des bandes, quelques baies jumelées aux étages ; les nos 162 (1911), 164 (1911), 203 (1908), 205, 209 (1910, exhaussé d'un niveau en 1928), 211 (1909), 214, 235 (1911, exhaussement d'un niveau, belles baies jumelées cintrées).
Signalons quelques immeubles de l'entre-deux-guerres, tels les nos 216 (1923, arch. J. FINNÉ) et 239 (1925, arch. P. ONGENAE), et un certain nombre d'immeubles à appartements modernes, comme les nos 102 à 118 de cinq niveaux (1975, arch. J. DE MESMAEKER), construits pour Le Foyer etterbeekois, comme en témoigne l'inscription suivante : « MR. LÉON DEFOSSET DÉPUTÉ BOURGMESTRE D'ETTERBEEK A POSÉ LA 1 ERE PIERRE DE CES IMMEUBLES DU FOYER ETTERBEEKOIS LE 9.6.1976 », et les nos 198-200 (1968).
Sources
Archives
ACEtt./TP 12284 (1901), 13890, 14099 (1902), 1913 (1907), 3876 (1908), 3203 (1909), 438 (1910), 198 (1911), 1130, 2329, 2509 (1911), 2599 (1912), 4140 (1923), 6947 (1925), 1919 (1928), 39/ 3140 (1938), 272 (1939), 742 (1947), Reg. d'entrée 2258 (1968), 2733 (1975).
AR 16.05.1883, 03.12.1885, 18.1.1893.
CC 30.01.1898.
RC 1903, pp. 441 et 470, 1912, p. 9, 1913, p. 10.
TP, f 93, AGR 412.
AR 16.05.1883, 03.12.1885, 18.1.1893.
CC 30.01.1898.
RC 1903, pp. 441 et 470, 1912, p. 9, 1913, p. 10.
TP, f 93, AGR 412.