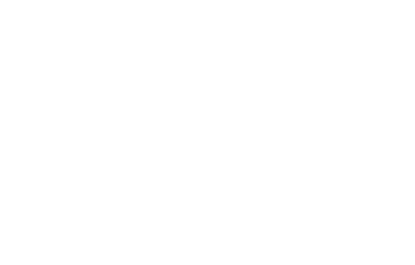Recherches et rédaction
1993-1995
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
Tracée en 1906, cette artère rectiligne, qui porte le nom d'un échevin d'Etterbeek, relie la r. Père de Deken au bd Saint-Michel.
À l'origine, la r. Charles Legrelle se prolongeait, au-delà du bd Saint-Michel, par l'act. r. Père Eudore Devroye (celle-ci reçut son nom après la Première Guerre mondiale). La section située entre la r. Père de Deken et l'av. de l'Armée qui la traverse n'est achevée qu'en 1923.
Des deux côtés, ensemble de maisons et d'immeubles à appartements dont les plus anc. se situent entre l'av. de l'Armée et le bd Saint-Michel. Il reste quelques constructions du début du XXe s., généralement sous bâtière, d'inspiration néoclassique tel le no 23 (1906, façade enduite, ouvertures surbaissées aux encadrements plats) ou bâties dans le style éclectique traditionnel de cette époque (façades en briques de deux ou trois niveaux souvent sur caves hautes et généralement deux travées inégales) tels les nos 16 (1921, arch. Léon SMETS) et 25 (1908).
On note par ailleurs de nombreuses constructions des années 1920, dont certaines affichent une influence Art Déco comme les nos 8 (1926, arch. Paul HAMESSE ET FRÈRES) et 33 (commencé en 1914, achevé en 1922, arch. A. et V. DANLÉE et Ernest HÉRENT) ou Beaux-Arts comme les nos 34 (1921, arch. M. GENARD) et 54 (1922).
Aux angles avec l'av. de l'Armée et la r. des Atrébates, des immeubles plus importants généralement à pan coupé tels les nos 17 (1925, façade enduite, pan arrondi), 22 (1911, r.d.ch. commercial, plusieurs linteaux en pierre bleue ouvragée et rouleaux d'archivolte brisés à volutes rentrantes) ou 37 (1920, anc. avec r.d.ch. commercial).
La rue compte plusieurs immeubles à appartements modernes.
À l'origine, la r. Charles Legrelle se prolongeait, au-delà du bd Saint-Michel, par l'act. r. Père Eudore Devroye (celle-ci reçut son nom après la Première Guerre mondiale). La section située entre la r. Père de Deken et l'av. de l'Armée qui la traverse n'est achevée qu'en 1923.
Des deux côtés, ensemble de maisons et d'immeubles à appartements dont les plus anc. se situent entre l'av. de l'Armée et le bd Saint-Michel. Il reste quelques constructions du début du XXe s., généralement sous bâtière, d'inspiration néoclassique tel le no 23 (1906, façade enduite, ouvertures surbaissées aux encadrements plats) ou bâties dans le style éclectique traditionnel de cette époque (façades en briques de deux ou trois niveaux souvent sur caves hautes et généralement deux travées inégales) tels les nos 16 (1921, arch. Léon SMETS) et 25 (1908).
On note par ailleurs de nombreuses constructions des années 1920, dont certaines affichent une influence Art Déco comme les nos 8 (1926, arch. Paul HAMESSE ET FRÈRES) et 33 (commencé en 1914, achevé en 1922, arch. A. et V. DANLÉE et Ernest HÉRENT) ou Beaux-Arts comme les nos 34 (1921, arch. M. GENARD) et 54 (1922).
Aux angles avec l'av. de l'Armée et la r. des Atrébates, des immeubles plus importants généralement à pan coupé tels les nos 17 (1925, façade enduite, pan arrondi), 22 (1911, r.d.ch. commercial, plusieurs linteaux en pierre bleue ouvragée et rouleaux d'archivolte brisés à volutes rentrantes) ou 37 (1920, anc. avec r.d.ch. commercial).
La rue compte plusieurs immeubles à appartements modernes.
Sources
Archives
AR 04.05.1919.
ACEtt/TP 693 (1906), 3909 (1908), 4010 (1911), 371 (1914), 773 (1921 av. de l'Armée), 1402 (1921), 2185 (1922), 1855 (1923), 7265 (1925), 8122 (1926), Reg. d'entrée 1821 (1955).
RPV 1919, p. 58, 1922, p. 342.
Ouvrages
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Bruxelles, 1981, p. 98.
ACEtt/TP 693 (1906), 3909 (1908), 4010 (1911), 371 (1914), 773 (1921 av. de l'Armée), 1402 (1921), 2185 (1922), 1855 (1923), 7265 (1925), 8122 (1926), Reg. d'entrée 1821 (1955).
RPV 1919, p. 58, 1922, p. 342.
Ouvrages
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Bruxelles, 1981, p. 98.