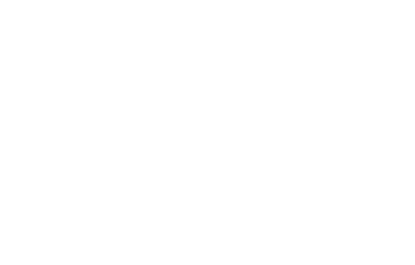Recherches et rédaction
Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire
Ancienne route de Bruxelles vers Louvain, la chaussée traverse cinq communes sur le territoire de la région bruxelloise. Elle débute à la Porte de Louvain, l'actuelle place Madou, sur Saint-Josse-ten-Noode, puis effectue un bref passage par le quartier Nord-Est, dont elle constitue la limite nord-ouest, avant de continuer sur Schaerbeek, Evere, Woluwe-Saint-Lambert pour terminer peu avant la ville de Louvain.
Seul le côté pair de l'artère se situe sur le territoire de la Ville de Bruxelles, du no 216, à l'angle de la rue du Cardinal, au no 368, qui porte également le no 1 de la rue du Noyer.
La route originelle était pavée, en 1459 au plus tard, jusqu'au bois de Linthout. Elle est transformée en chaussée en vertu d'un octroi du roi Philippe V du 24.07.1704. Son alignement, à Saint-Josse-ten-Noode, est déterminé par l'arrêté royal du 04.10.1817 (WAUTERS, A., 1973, pp. 21, 24). La chaussée fait par la suite l'objet d'un plan général d'alignement, approuvé par arrêté royal en date du 19.05.1851 (AVB/TP 29046).![La chaussée de Louvain, détail de la [i]Carte de Bruxelles et ses environs[/i], dressée par G. de Wauthier vers 1821 (© Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, Section Cartes et Plans).](/medias/500/streets/10005069_Z01.jpg)
Le 02.07.1853, est adopté par le Conseil communal le tracé du chemin de fer de ceinture est, reliant la gare du Nord à la gare du quartier Léopold (AVB/PP 327). Celui-ci suit le tracé des actuelles rues Georges Petre, sur Saint-Josse, et John Waterloo Wilson. Le chemin de fer enjambe alors la chaussée de Louvain au moyen d'un viaduc.![La chaussée de Louvain, encore enjambée par la voie de chemin de fer, détail du plan [i]Bruxelles et ses environs[/i], réalisé par l’Institut cartographique militaire en 1881 (© Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, Section Cartes et Plans).](/medias/500/streets/10005069_Z02.jpg)
Suite à la demande du Gouvernement d'ériger une station contre le viaduc, l'alignement de la chaussée est revu en deçà et au-delà de l'ouvrage, une rectification approuvée par arrêté royal du 30.09.1865 (AVB/TP 29046). En date du 12.09.1870, un arrêté royal modifie à nouveau l'alignement de l'artère.![La chaussée de Louvain, après déplacement de la ligne de chemin de fer sous le boulevard Clovis, détail du plan [i]Bruxelles et ses environs[/i], réalisé par l’Institut cartographique militaire en 1894, AVB/TP 16767.](/medias/500/streets/10005069_Z03.jpg)
Au début des années 1880, alors que l'aménagement du quartier Nord-Est est en cours, les communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek demandent que la ligne de chemin de fer soit déplacée vers l'est (Bulletin communal…, 1881, t. II, pp. 379-381). Sur Bruxelles, cette modification de tracé permet d'enterrer la ligne sous le boulevard Clovis et de créer la rue Wilson à son ancien emplacement. Une gare est bâtie sur la chaussée, côté Saint-Josse-ten-Noode, en 1884-1885 (voir chaussée de Louvain no 195-195a).
Dans les années 1890, la ligne de tramway Bruxelles-Sterrebeek emprunte la rue de Pavie et la chaussée de Louvain. Afin de permettre l'établissement d'une double voie au croisement de ces deux artères, l'État belge achète, le 25.08.1893, au nom de la Société des Chemins de Fer vicinaux, le terrain d'angle côté impair afin d'y créer un pan coupé d'une quinzaine de mètres de long. L'arrêté de création du pan est adopté en séance du Collège de la Ville de Bruxelles du 22.12.1902 (Bulletin communal, 1902, t. II, pp. 812, 1043).
En 1922, une partie du tunnel du chemin de fer s'effondre, à l'angle de la chaussée de Louvain et de la rue Charles Quint. La maison portant le no 258 de la chaussée, conçue en 1860, est détruite. Elle formait sur l'alignement du boulevard Clovis une saillie de près de quatre mètres, « peu favorable au point de vue de l'aspect et de la circulation ». Par arrêté royal du 08.06.1923, il est donc décidé d'établir un pan coupé à cet endroit (AVB/TP 65396). La nouvelle parcelle est bâtie d'un immeuble d'angle conçu en 1924 par l'architecte Louis Kuypers, dans un style éclectique fort tardif pour l'époque.
À sa sortie du hameau de Saint-Josse, la chaussée de Louvain longeait à l'origine des champs. Elle était ponctuée çà et là de constructions. Le bâti se densifie durant les années 1860 ; il s'agit de maisons modestes, d'un à trois étages.
Sur le tronçon allant des nos 296 à 306, est érigée une cité ouvrière conçue par l'architecte Gédéon Bordiau en 1875, soit l'année même de l'approbation de son plan d'aménagement du quartier Nord-Est. Commandé par la Société anonyme des Habitations ouvrières dans l'Agglomération bruxelloise, cet ensemble de 24 maisons s'étend sur tout l'îlot compris entre la chaussée, les rues de Pavie, du Carrousel et Charles Quint (voir rue du Carrousel).
Les autres habitations bordant la chaussée sont pour la plupart conçues dans les années 1890 ou 1900, les premières étant plutôt d'inspiration néoclassique, les secondes de style éclectique. Certains de ces bâtiments remplacent ou résultent de la profonde modification de constructions des années 1860.
En 1903 et 1904, l'architecte Gustave Strauven conçoit deux maisons à rez-de-chaussée commercial sur la portion d'artère située sur le territoire de Bruxelles (voir nos 282 et 332).
Le bâti de la chaussée a été fortement modifié au cours du temps : surhausses, revêtements de briquettes ou remplacements d'huisserie. De nombreuses maisons ont été dotées, dès l'origine ou ultérieurement, d'un rez-de-chaussée commercial. La plupart de ceux-ci ont été transformés à plusieurs reprises.
Au no 230, un garage est ouvert en 1920 ; il sera modifié plusieurs fois par la suite. Le rez-de-chaussée du no 274-276, conçu en 1903, abritait à l'origine un café, ouvert par des arcades en plein cintre. En 1919, la salle de danse « La Madelon », située au no 286, est dotée d'une entrée à front de rue de style éclectique, conçue par l'architecte Robert Crignier. La salle est reconvertie en cinéma en 1930. Cinq ans plus tard le complexe est remplacé par un petit immeuble moderniste.
Aux nos 310-314 et rue de Pavie 121, l'angle est occupé par un ensemble fort transformé de maisons à rez-de-chaussée commercial conçues en 1904 pour un certain Bogaers. Le même propriétaire a conçu pas moins de six ensembles similaires dans le quartier (voir rues John Waterloo Wilson, de Gravelines et des Éburons).
Sources
Archives
AVB/TP 29046 (1861-1865), 14968 (1876), 65396 (1922) ; 230 : 29587 (1923) ; 258 : 14972 (1860), 44702 (1922), 31805 (1924) ; 274-276 : 14987 (1903) ; 286 : 21697 (1919), 37040 (1930), 44868 (1935) ; 310-314 et rue de Pavie 121 : 14993 (1904) ; 296 à 306 : voir rue du Carrousel.
AVB/PP 327.
AVB/Bulletin communal de Bruxelles, 1865, t. II, pp. 13-14, 39 ; 1881, t. II, pp. 379-381 ; 1902, t. II, pp. 812, 1043.
Ouvrages
WAUTERS, A., Histoire des environs de Bruxelles, ou description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville [1855], Livre huitième – A, éd. Culture et Civilisation, Bruxelles, 1973, pp. 21-24.